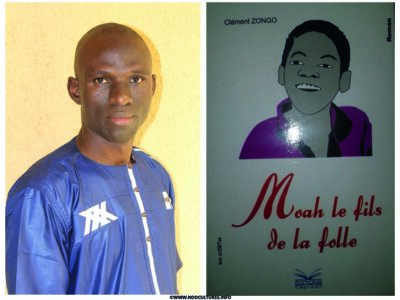Le vendredi 31 mai, à l’Institut français du Congo, s’est tenu une rencontre littéraire autour du livre Une peur morbide de Jessy Loemba, paru en 2018 aux éditions Langlois Cécile. Auteur de deux romans, Jessy Loemba a publié, avec Une peur morbide, son premier recueil de nouvelles.
Jessy Loemba n’échappe pas à l’élan classique de la satire; si on l’entend, lato sensu, comme l’usage du risible pour châtier les vices et les sottises des hommes. Il n’est pas nouveau, mais il reste pertinent, de remuer les références les plus rebattues comme celles du théâtre moliéresque, ou, plus proche de nous, des outrances de Sony Labou Tansi dans La vie et demie ou d’Henri Lopès dans Le Pleurer-Rire.
Nicolas Martin-Granel consacre, d’ailleurs, tout un essai, intitulé Rires noirs, à la fonction du risible de la littérature africaine. Boniface Mongo-Mboussa le présente aussi comme une sorte de contrepied de la lamentation, dans L’indocilité (Supplément au Désir d’Afrique), de quoi nous renvoyer au Barbier de Séville de Beaumarchais où Figaro, répondant au Comte Almaviva, affirme : « J’ai beau pleurer, il faut toujours que le rire s’échappe par quelque coin », de quoi inférer que les voix les plus subversives ne manquent pas d’humour; elles soulignent la cruauté, l’amertume, le désespoir et l’absurdité d’un monde face auquel elles constituent une forme de défense.
Dès l’exergue, transparaît l’intention de l’auteur. Il reprend une citation de Christian Sédar Ndinga, extraite du livre Chroniques de l’ombre : « J’ai mal à mon pays ». Par une, non moins expresse, mesure des choses, l’ouvrage se clôt avec une nouvelle dont le titre rend évidentes les crises sociales – et même politiques – décriées par l’auteur, nouvelle après nouvelle : Bual bua fua, que l’on traduirait, dans ce cas précis, comme une certaine idée du chaos.
La première nouvelle, Une peur morbide, éponyme du livre, oppose le truisme au grotesque. S’il semble superflu à M. Roblot de dire que le voyage en avion ne fait pas seul courir le risque de la mort, M. Lopes, dont la trémeur est manifeste, contredit l’évidence avec une niaiserie qui ne sépare pas la conviction profonde de la surexcitation. Si M. Roblot s’ébahit du fait qu’on applaudisse à l’atterrissage d’un avion, M. Lopes, lui, évoque « la magie terrifiante des Blancs » (page 19).
Dans Cour commune, à la page 41, l’auteur joue sur la caricature, pour tourner en dérision le maire du 10e arrondissement qui, après une altercation avec le directeur de l’hôpital, répond à la presse : « Ce petit-là, le directeur de l’hôpital (…) Il m’a injurié des injures qu’on n’injurie pas à quelqu’un ». La phrase apparaît comme la traduction littérale du lari « Ku ntukiri bituku biba lombo tukaka ». C’est une battologie qui, loin de renforcer le discours, lui confère une emphase grossière et réduit le personnage au rang du bouffon.
Le grotesque demeure, non sans l’absurde, comme pour les précédents exemples, avec la mort du lieutenant Richard-Dorian, dont le cœur a arrêté de battre avant des ébats amoureux, à cause d’un trop-plein d’aphrodisiaques que le narrateur décrit dans un élan diégétique qui favorise l’enflure. La mort du personnage suggère le rire, plutôt que le pleur.
A côté de l’emphase de l’anecdote, l’auteur impose un ton grave, dans la nouvelle Une vanité. C’est la désillusion d’un homme qui découvre l’échec. Pourtant, la dernière phrase est un sursaut de résilience : « Le seul échec, c’est de cesser d’essayer ».
C’est certainement aussi le fil d’Ariane de l’auteur qui, ayant mal à son pays, toujours fait un contrepied à la lamentation, avec humour ou philosophie, voire avec humour et philosophie. Il n’est pas rare qu’il rompe la narration pour emprunter le ton discursif de celui qui opine. Si Une peur morbide et Une vanité ont, aux dernières pages, un ton d’une clausule, dans Cour Commune page 33 et Bual bua fua page 90 l’auteur pose des questions-constats, dénonce frénétiquement, use à l’envi de particules vocatives, d’interjection, d’exclamation, de parallélisme et d’anaphore; une tentation à la ratiocination que l’on retrouve chez bien des contemporains, à l’instar de Prince Arnie Matoko dans Un voyage à New ou Ces fruits de mon jardin intérieur.
Ce fil d’Ariane renvoie aussi à une certaine transversalité : la littéracité martiale de Jessy Loemba. Si le champ lexical est un salmigondis de congolismes et de lieux communs, il n’en demeure pas moins que l’auteur des Souvenirs tragiques propose un vocabulaire de caserne, dans Cour commune, Une vanité et, quelque peu, dans Bual bua fua et que la vie militaire est indissociable de son remuement créatif.
Émeraude Kouka,
Critique littéraire et critique d’art.